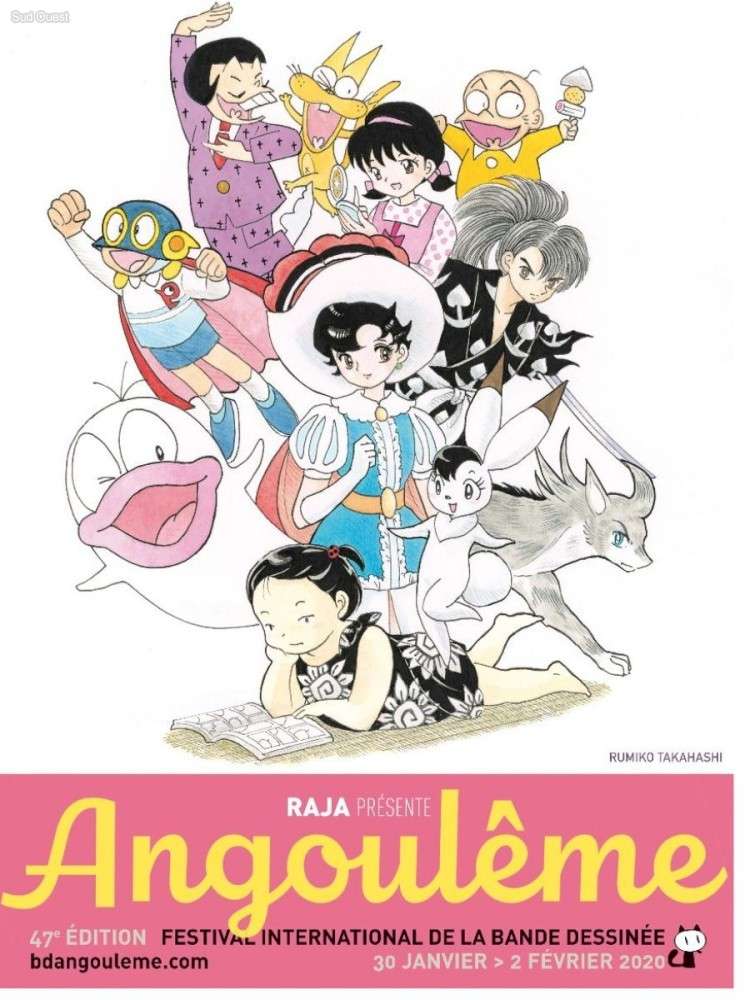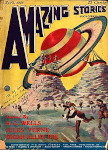 Sur ce point, il y a des travaux très bien fait et je
vous invite donc à consulter la biblio/webographie de fin. Je vais quand
même poser ici quelques éléments historiques.
Sur ce point, il y a des travaux très bien fait et je
vous invite donc à consulter la biblio/webographie de fin. Je vais quand
même poser ici quelques éléments historiques. 
 1961, en France : le
même scénario semble se répéter. En effet, une revue de Science-Fiction2 publie le courrier d’un lecteur
qui évoque les bandes dessinées de son enfance. Ces mots trouvent une
audience inattendue. Les adultes qui lisaient de la BD se sentaient isolés
et incompris. Cette publication en fait naître une autre en 1962 : Giff-Wiff. Le premier numéro n’est qu’un
bulletin de quelques pages ronéotypées3,
mais c’est le premier fanzine français connu (par moi en tout cas). C’est
beau. Pourtant, Giff-Wiff ne se dit pas
fanzine. D’autres vont arriver : Phénix, Schtroumpf et d’autres4. Ils vont s’imiter ou, au contraire, vouloir
se créer en opposition. En tout cas, tous chercheront à promouvoir leur
passion pour la BD notamment auprès d’un public adulte.
1961, en France : le
même scénario semble se répéter. En effet, une revue de Science-Fiction2 publie le courrier d’un lecteur
qui évoque les bandes dessinées de son enfance. Ces mots trouvent une
audience inattendue. Les adultes qui lisaient de la BD se sentaient isolés
et incompris. Cette publication en fait naître une autre en 1962 : Giff-Wiff. Le premier numéro n’est qu’un
bulletin de quelques pages ronéotypées3,
mais c’est le premier fanzine français connu (par moi en tout cas). C’est
beau. Pourtant, Giff-Wiff ne se dit pas
fanzine. D’autres vont arriver : Phénix, Schtroumpf et d’autres4. Ils vont s’imiter ou, au contraire, vouloir
se créer en opposition. En tout cas, tous chercheront à promouvoir leur
passion pour la BD notamment auprès d’un public adulte. 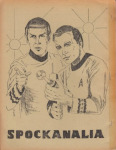 Les années 60, c’est aussi
le développement de la littérature homoérotique anglo-américaine,
autrement dit, du slash5. L’exemple
le plus connu (et qui a donné son nom au slash) est un fanzine consacré à
Star Trek qui a mis en scène le couple Kirk / Spock (connu
aussi sous l’abréviation K/S). Bien sûr, d’autres séries ont eu le droit à
leurs publications de fans (Starsky et Hutch par exemple).
Les années 60, c’est aussi
le développement de la littérature homoérotique anglo-américaine,
autrement dit, du slash5. L’exemple
le plus connu (et qui a donné son nom au slash) est un fanzine consacré à
Star Trek qui a mis en scène le couple Kirk / Spock (connu
aussi sous l’abréviation K/S). Bien sûr, d’autres séries ont eu le droit à
leurs publications de fans (Starsky et Hutch par exemple). 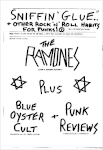 C’est en effet ce titre qui
sera régulièrement cité comme l’inspirateur de la vague de fanzines punk.
Sniffin’Glue applique les principes D.I.Y.
(Do It Yourself / Fais le toi-même) défendus par le punk. Son créateur,
Mark Perry, insatisfait parce qu’il ne trouvait pas de publication sur son
groupe favoris, relève le défi lancé par son disquaire9 :
« Si t’es pas content, t’as qu’à le faire toi-même. »10
C’est en effet ce titre qui
sera régulièrement cité comme l’inspirateur de la vague de fanzines punk.
Sniffin’Glue applique les principes D.I.Y.
(Do It Yourself / Fais le toi-même) défendus par le punk. Son créateur,
Mark Perry, insatisfait parce qu’il ne trouvait pas de publication sur son
groupe favoris, relève le défi lancé par son disquaire9 :
« Si t’es pas content, t’as qu’à le faire toi-même. »10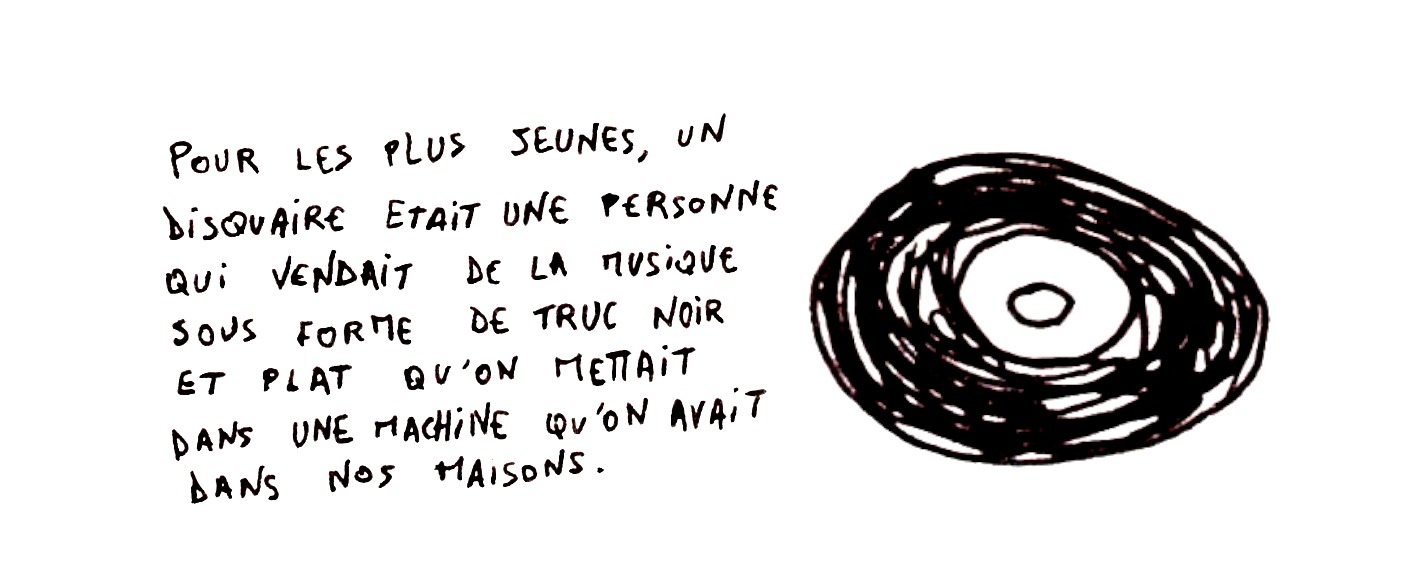
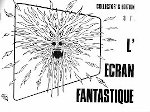 Dans
les années 70, des fanzines de cinéma se développent. Il s’agit surtout de
revues spécialisées dans le genre fantastique et le cinéma de genre qui
est considéré comme un produit de mauvaise qualité et auquel les fans
cherchent à donner une respectabilité. Parmi ces fanzines, on trouve l’Écran fantastique (qui débute
en 1969, avec 34 pages imprimées en ronéographie), Mad
Movies (qui commence en 1972 avec un tirage de 120
exemplaires. Il arrête d’être un fanzine pour être vendu en kiosque en
1982). Ces deux exemples sont toujours trouvables aujourd’hui chez
votre marchand de
Dans
les années 70, des fanzines de cinéma se développent. Il s’agit surtout de
revues spécialisées dans le genre fantastique et le cinéma de genre qui
est considéré comme un produit de mauvaise qualité et auquel les fans
cherchent à donner une respectabilité. Parmi ces fanzines, on trouve l’Écran fantastique (qui débute
en 1969, avec 34 pages imprimées en ronéographie), Mad
Movies (qui commence en 1972 avec un tirage de 120
exemplaires. Il arrête d’être un fanzine pour être vendu en kiosque en
1982). Ces deux exemples sont toujours trouvables aujourd’hui chez
votre marchand de  journaux. Dans son entretien
pour le site du fanzinophile, Lucas Balbo explique que l’époque où il
faisait son fanzine Nostalgia
(les années 80) était riche en fanzines : « C’était l’explosion
du fanzinat probablement due à la vidéo qui permettait des cinéphilies un
peu plus extrêmes. »13
journaux. Dans son entretien
pour le site du fanzinophile, Lucas Balbo explique que l’époque où il
faisait son fanzine Nostalgia
(les années 80) était riche en fanzines : « C’était l’explosion
du fanzinat probablement due à la vidéo qui permettait des cinéphilies un
peu plus extrêmes. »13
 C’est
une association qui avec l’aide de la mairie va ouvrir un lieu qui va
conserver les fanzines. Si j’ai l’impression qu’elle s’est créé autour de
la scène punk19, cette jeune
structure a aussi investi le réseau
BD, notamment en participant au festival d’Angoulême.
C’est
une association qui avec l’aide de la mairie va ouvrir un lieu qui va
conserver les fanzines. Si j’ai l’impression qu’elle s’est créé autour de
la scène punk19, cette jeune
structure a aussi investi le réseau
BD, notamment en participant au festival d’Angoulême. 
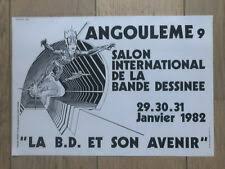 Fin des années 80 (en
Angleterre d’abord, puis en France), les association de supporters de
football changent de support d’information : terminés les affiches ou
les feuillets distribuées avant le match. Le fanzine s’impose à des
supporters révoltés par l’état du football à cette époque (médiatisation,
argent...). Il s’agit d’abord de fanzines pour les supporters d’une même
équipe, puis (à partir du début des années 90) apparaissent des zines plus
« généralistes » qui font le lien entre les fans de clubs
différents.20
Fin des années 80 (en
Angleterre d’abord, puis en France), les association de supporters de
football changent de support d’information : terminés les affiches ou
les feuillets distribuées avant le match. Le fanzine s’impose à des
supporters révoltés par l’état du football à cette époque (médiatisation,
argent...). Il s’agit d’abord de fanzines pour les supporters d’une même
équipe, puis (à partir du début des années 90) apparaissent des zines plus
« généralistes » qui font le lien entre les fans de clubs
différents.20 
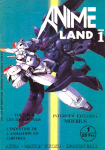 C’est en 1990 que
sort Mangazone, le premier fanzine manga
français. Très vite un deuxième opus paraît en lien avec le fanzine Scarce21. Il est suivi en 1991 par Animeland (qui parle plus de japanimation
que de manga).
C’est en 1990 que
sort Mangazone, le premier fanzine manga
français. Très vite un deuxième opus paraît en lien avec le fanzine Scarce21. Il est suivi en 1991 par Animeland (qui parle plus de japanimation
que de manga). 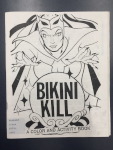 1991 : Début du mouvement
Riot Girrls ou Riot Grrrl22. Des
groupes musicaux de filles en colère se forment et des fanzines
apparaissent comme Bikini Kill Zine.
1991 : Début du mouvement
Riot Girrls ou Riot Grrrl22. Des
groupes musicaux de filles en colère se forment et des fanzines
apparaissent comme Bikini Kill Zine. 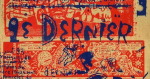 1993
: Premières publications du Dernier Cri
par Paquito Bolino et Caroline Sury qui influencent encore aujourd'hui
toute la scène Graphzine.
1993
: Premières publications du Dernier Cri
par Paquito Bolino et Caroline Sury qui influencent encore aujourd'hui
toute la scène Graphzine. 
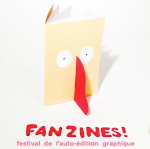
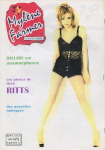
Rappel concernant le vocabulaire : Même si je
considère les fans de mangas et de japanimation
comme un tout, je distingue bien ces deux objets :
• manga : bande dessinée japonaise, donc un
imprimé.
• japanimation
: dessin animé, donc de la vidéo.
Par simplification, je parlerai de « fanzine manga ».
 Il y a eu un première
introduction de Bd japonaise dans les années 60 en France avec
le magazine Budo (consacré aux arts martiaux) et, dans les
années 70, le Cri qui tue (la première revue française consacrée à
la BD japonaise). La plupart des animéfans
n’évoquent pas ces parutions (contrairement aux fans de BD) et pourtant,
elles ont eu un impact. Personnellement, je ne l’aurais pas su si je
n’avais pas fait ce travail de recherche.
Il y a eu un première
introduction de Bd japonaise dans les années 60 en France avec
le magazine Budo (consacré aux arts martiaux) et, dans les
années 70, le Cri qui tue (la première revue française consacrée à
la BD japonaise). La plupart des animéfans
n’évoquent pas ces parutions (contrairement aux fans de BD) et pourtant,
elles ont eu un impact. Personnellement, je ne l’aurais pas su si je
n’avais pas fait ce travail de recherche.
Dominique Veret (créateur de Tonkam) dans une interview au fanzine Vision Parallèle n°3 p.47 (1995) : « Personnellement, mes relations avec le manga débutent dans les années 70 avec Le Cri qui Tue et la pratique des Arts Martiaux (la génération Bruce Lee). »
 Quelques dessins animés
japonais sont diffusés en France, dès le début des années 7028, mais c’est Goldorak qui marque
vraiment les esprits. Il va faire vibrer la France en 1978.
Quelques dessins animés
japonais sont diffusés en France, dès le début des années 7028, mais c’est Goldorak qui marque
vraiment les esprits. Il va faire vibrer la France en 1978.
Les premiers mangas à être publiés en France (hors magazine) sont :
• Le Vent du nord est comme le hennissement d'un
cheval noir, recueil de Sabu & Ichi en 1979, coédité
par Kesselrinf et Atoss Takemoto (Le Cri qui tue)
• Hiroshima, de Yoshihiro Tatsumi, chez
Artefact, qui reprend des histoires du Cri qui tue
• Gen d’Hiroshima de Keiji Nakazawa en 1983
par les Humanoïdes Associés. C’est, comme les deux titres précédents, un
échec qui s’arrête dès le premier tome. La série sera rééditée plus tard
(et tant mieux).
En 1984, c’est l’arrivée de la chaîne payante Canal +. Elle
diffuse quelques programmes japonais dont Sherlock Holmes, Bioman
et Cobra.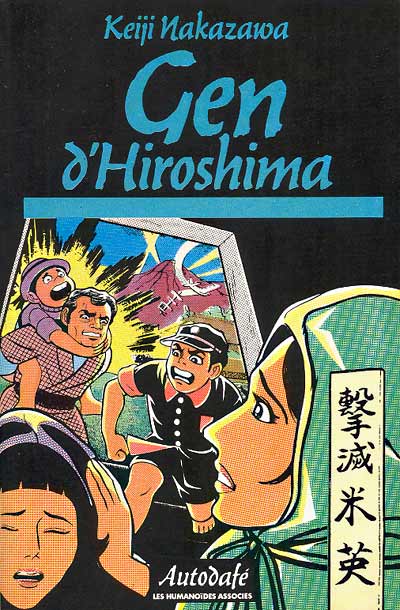
Le début du Club Dorothée et l’apparition de la cinquième chaîne
en 1987 sont les véritables coups d’envoi au développement du
dessin animé japonais en France.
Même si les dessins animés ont trouvé un chemin jusqu’aux petits
français, les mangas sont quasi-inexistants… sauf des versions
américaines dans les magasins d’imports.
En 1987, quelques mangas ont été traduit aux États-Unis :
• Mai, The Psychic Girl de Kazuya Kudo et
Ryoichi Ikegami (manga JP Shogakukan 1985
/ US chez Eclipse Comics et Viz Comics 1987 / FR chez Semic 1996 )
• Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike et Goseki
Kojima (manga JP Futabasha 1972 / US First Comics 1987 / FR Panini
2003)
 • Area
88 de Kaoru Shintani (manga JP Shogakukan 1979 / US chez Eclipse
Comics et Viz Comics 1987 / Jamais sorti en FR),
• Area
88 de Kaoru Shintani (manga JP Shogakukan 1979 / US chez Eclipse
Comics et Viz Comics 1987 / Jamais sorti en FR),
• Legend of Kamui de Sanpei Shirato (manga JP
Shogakukan 1964 / US Eclipse Comics et Viz Comics 1987 / FR Kana sous le
titre de Kamui-den 2010)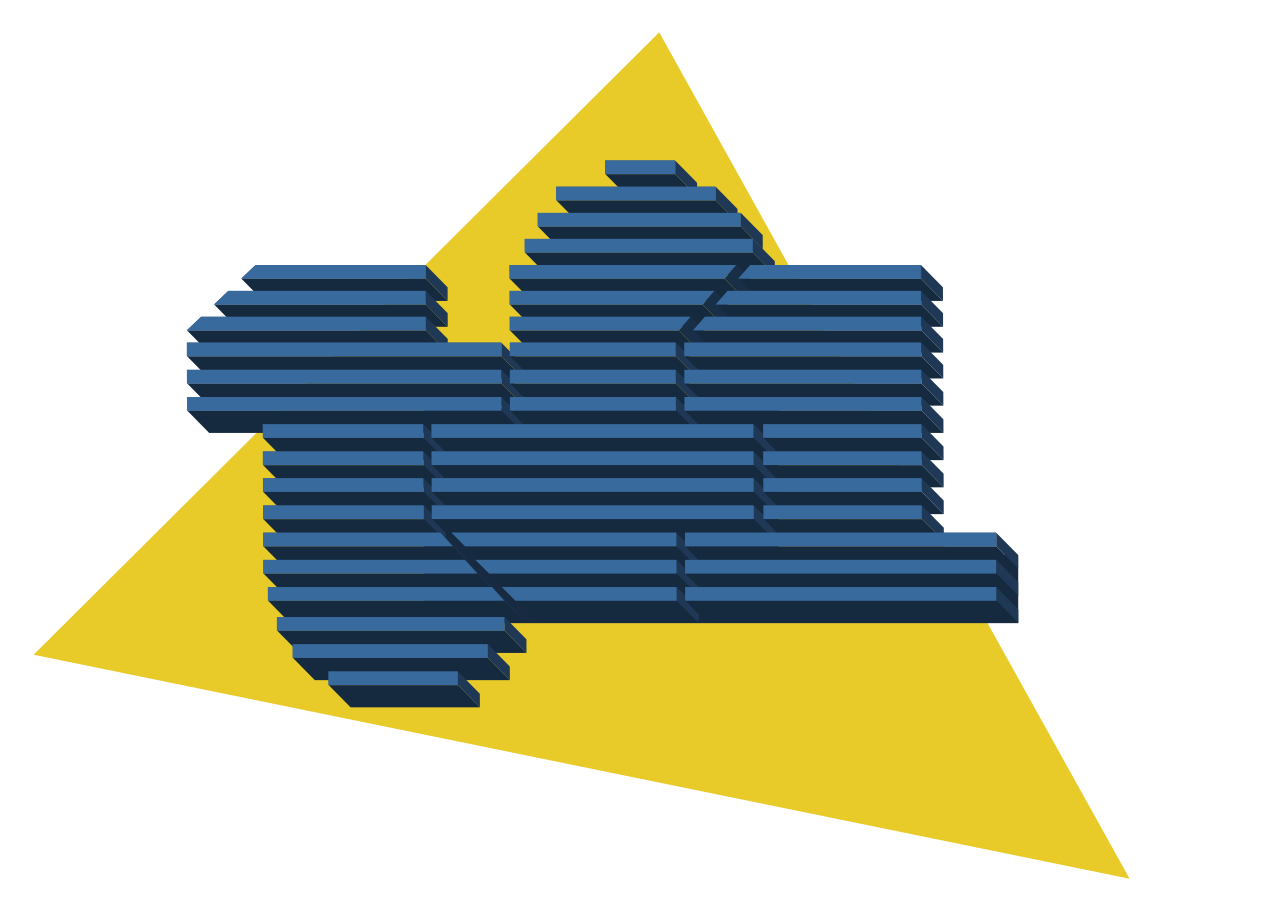
• Appleseed de Masamune Shirow (manga JP
Seishinsha 1985 / US Eclipse Comics 1988 / FR Glénat 1994)
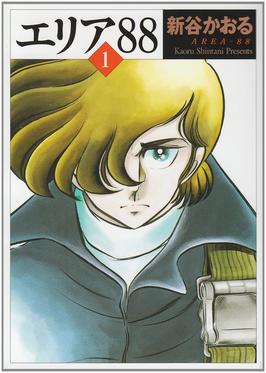 Le manga Akira de
Katsuhiro Otomo (manga JP Kodansha 1982 / US Epic Comics 1988 / FR
Glénat 1990) arrivera en 1988 chez Epic Comics. Ces publications
sont « arrangées » pour le public américain :
retournement des planches pour être dans le sens de lecture occidental
et colorisation… Ces modifications déplaisent aux puristes et aux
auteurs. Mais c’est par ces adaptations américaines qu’un public
français (déjà lecteur de comics) va découvrir le manga.
Le manga Akira de
Katsuhiro Otomo (manga JP Kodansha 1982 / US Epic Comics 1988 / FR
Glénat 1990) arrivera en 1988 chez Epic Comics. Ces publications
sont « arrangées » pour le public américain :
retournement des planches pour être dans le sens de lecture occidental
et colorisation… Ces modifications déplaisent aux puristes et aux
auteurs. Mais c’est par ces adaptations américaines qu’un public
français (déjà lecteur de comics) va découvrir le manga.
En 1988, l’import de produits japonais commence. Radio
Loustic émet dès 1989 et diffuse des génériques de
dessins animés. Le Club Dorothée qui a le vent en poupe commence
à publier son magazine en kiosque.
Ségolène Royal publie, en 1989, son livre : Le
Ras-le-bol des bébés zappeurs. Elle fait partie des détracteurs
des dessins animés japonais qui ont la faveur des médias à cette époque.
Ce débat déclenche la période « d’austérité » :
c’est-à-dire une période où il n’y aura quasiment aucun dessin animé
japonais sur les chaînes nationales.
 1990 : Sortie au
cinéma d’Akira. Glénat sort la BD de Katsuhiro Otomo la même
année. Il s’agit des planches américaines inversée : il ne faudrait
pas bouleverser le lecteur français. Mais 1990, c’est surtout la
sortie du premier fanzine manga français : Mangazone.
Le suivent de près (1991 et 1992) : Animeland,
Sumi Joohoo, Animapa
et Tsunami. Il s’agit
uniquement de fanzines d’articles. Ils émergent à un moment où la
diffusion des dessins animés japonais est remise en question :
polémique sur la violence, mort de la Cinq (chaîne télévisée nationale).
Les sitcoms d’AB production remplacent les animés.
Pour Clothide Sabre29, ce sont
ces scandales qui font découvrir aux enfants le pays d’origine de leurs
dessins animés préférés (p.198). Auparavant, aucun ne s’interrogeait
là-dessus, d’autant plus que les noms propres étaient francisés.
1990 : Sortie au
cinéma d’Akira. Glénat sort la BD de Katsuhiro Otomo la même
année. Il s’agit des planches américaines inversée : il ne faudrait
pas bouleverser le lecteur français. Mais 1990, c’est surtout la
sortie du premier fanzine manga français : Mangazone.
Le suivent de près (1991 et 1992) : Animeland,
Sumi Joohoo, Animapa
et Tsunami. Il s’agit
uniquement de fanzines d’articles. Ils émergent à un moment où la
diffusion des dessins animés japonais est remise en question :
polémique sur la violence, mort de la Cinq (chaîne télévisée nationale).
Les sitcoms d’AB production remplacent les animés.
Pour Clothide Sabre29, ce sont
ces scandales qui font découvrir aux enfants le pays d’origine de leurs
dessins animés préférés (p.198). Auparavant, aucun ne s’interrogeait
là-dessus, d’autant plus que les noms propres étaient francisés. 
Un autre manga de Katsuhiro Otomo est publié en France par les
Humanoïdes Associés en 1991. Il s’agit de Dômu – Rêves
d’enfants (manga JP 1980 / FR 1991).
Malgré une raréfaction des animés
nippons sur les grilles de programmes TV, des conventions
ont lieu dès 1992 à Paris (au sein de BD Expo) et à Toulon
(Cartoonist). Les éditeurs se lancent enfin dans des collections mangas
avec quelques titres marquants : Dragon Ball chez Glénat (1993)
et Vidéo Girl Aï chez Tonkam, à 4 000 exemplaires (manga JP
1990 / FR 1994). On trouve chez Kaze les VHS des OAV
des Chroniques de la guerre de Lodoss (OAV
JP 1991 / FR 1994) suivi par Glénat et son édition de Dr Slump
(FR 1995). Des magazines (comme Kaméha et Okaz)
consacrés aux mangas paraissent en kiosque et permettent de créer du
lien entre membres de la communauté de fans.
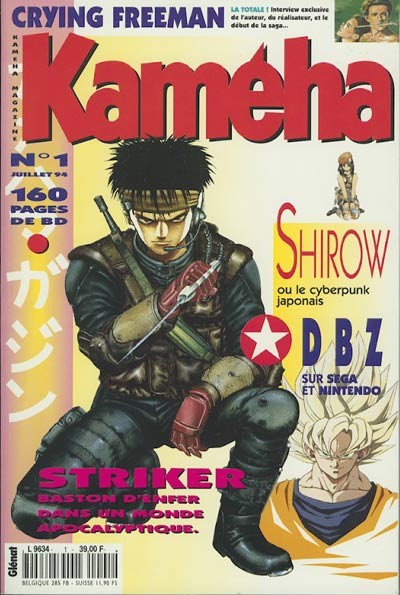 Kaméha magazine (32
numéros de juillet 1994 à janvier 1998)
Kaméha magazine (32
numéros de juillet 1994 à janvier 1998)
Revue publiée par Glénat qui publiait des mangas (par chapitre) certains
en prépublication avant le recueil (Riot, Striker, Crying Freeman…).
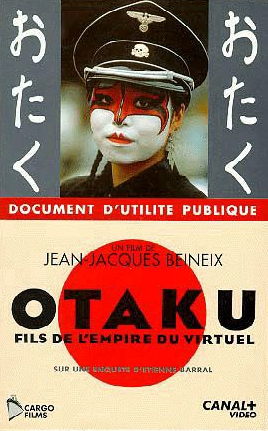 En 1994, la chaîne
France 2 diffuse le film documentaire de Jean Jacques Beineix : Otaku, fils de l'empire du
virtuel. Le mot Otaku se
popularise en France, mais aussi sa connotation négative. Les fans sont
durablement marqués par ce film et la mauvaise image qu’il donne de
leurs homologues japonais. Le discours des otakus
français va se construire contre ce film. Vous pouvez regarder
l’article de Wikipédia qui évoque la controverse que le film avait
pu provoquer à l’époque.
En 1994, la chaîne
France 2 diffuse le film documentaire de Jean Jacques Beineix : Otaku, fils de l'empire du
virtuel. Le mot Otaku se
popularise en France, mais aussi sa connotation négative. Les fans sont
durablement marqués par ce film et la mauvaise image qu’il donne de
leurs homologues japonais. Le discours des otakus
français va se construire contre ce film. Vous pouvez regarder
l’article de Wikipédia qui évoque la controverse que le film avait
pu provoquer à l’époque.
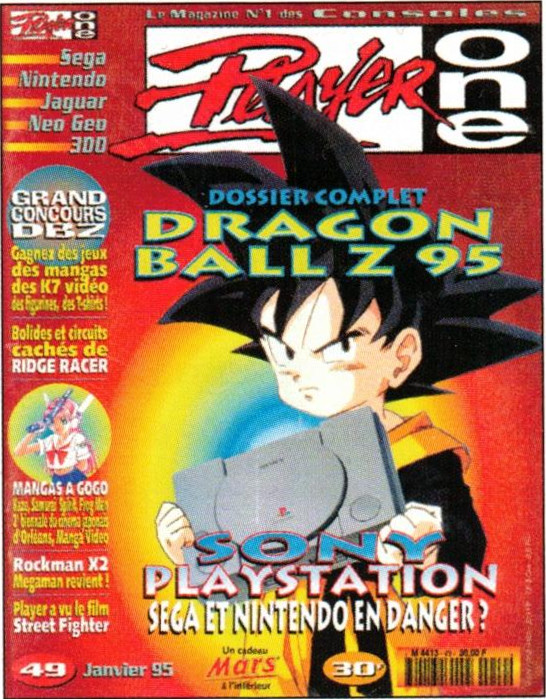 La folie autour de
Dragon Ball Z commence à prendre une ampleur inattendue à cette
époque30.
La folie autour de
Dragon Ball Z commence à prendre une ampleur inattendue à cette
époque30.
Du cul, du cul, du cul !… et de la
violence
On défendait vachement l’image du manga face aux accusations
d’immoralité, mais faut bien avouer que ce n’était pas toujours facile.
En effet, la revue Yoko31
faisait des couvertures très aguicheuses et contenaient des BD
érotiques, les éditeurs sortaient énormément de cassettes d’animés
de cul et certains de ces trucs se trouvaient en kiosque sans véritable
contrôle (Devinez comment je le sais : j’ai fait une partie de mon
éducation sexuelle sur un malentendu avec mon libraire… gros moment de
malaise).
Idem pour la violence : elle était parfois mise en valeur. Le
meilleur exemple est le clip
présentation sur la musique de Sepultura de la collection Manga
Vidéo32 qu’on trouvait
facilement dans son vidéo-club. C’est une suite de scènes gore assez
jouissif mais qui n’a pas dû jouer pour une bonne image du manga et de
la japanimation en
France...
Cette attitude ambigüe des éditeurs ne simplifiait pas la tâche des fans
militants qui répétaient sans cesse : « le manga, ce n’est
pas que du sexe et de la violence ».
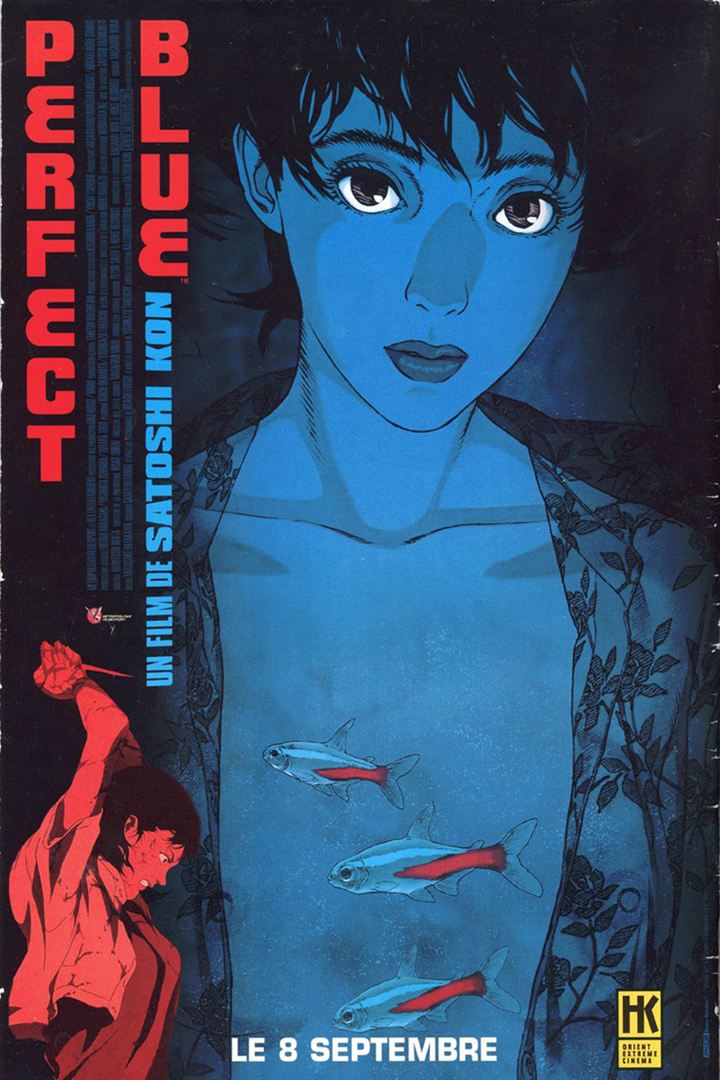 En 1995, les
premiers mangas en sens de lecture japonais commencent à paraître. On a
la surprise d’entendre parler de Christophe Gans, un réalisateur
français qui va adapter le manga Crying Freeman (cinéma US
1995-FR 1996) (manga JP 1986 / FR 1995). On voit des films de Miyazaki
au cinéma avec Porco Rosso. Il sera suivi de pleins
d’autres : après la TV (le Club Do s’arrête en 1997), les
kiosques et les librairies, c’est le cinéma qui est colonisé (Ghost
in the Shell, Jin Roh, Tombeau des lucioles, Perfect Blue…).
L’information sur le manga et les animés
circulent mieux (notamment avec l’arrivée d’internet). Les fans se
montrent donc de plus en plus exigeants, pourtant dans ces années là, à
peine une vingtaine de séries étaient traduites ou en cours de
traduction.
En 1995, les
premiers mangas en sens de lecture japonais commencent à paraître. On a
la surprise d’entendre parler de Christophe Gans, un réalisateur
français qui va adapter le manga Crying Freeman (cinéma US
1995-FR 1996) (manga JP 1986 / FR 1995). On voit des films de Miyazaki
au cinéma avec Porco Rosso. Il sera suivi de pleins
d’autres : après la TV (le Club Do s’arrête en 1997), les
kiosques et les librairies, c’est le cinéma qui est colonisé (Ghost
in the Shell, Jin Roh, Tombeau des lucioles, Perfect Blue…).
L’information sur le manga et les animés
circulent mieux (notamment avec l’arrivée d’internet). Les fans se
montrent donc de plus en plus exigeants, pourtant dans ces années là, à
peine une vingtaine de séries étaient traduites ou en cours de
traduction.
 1998 :
la chaîne (satellite) de télé AB Cartoons est renommée Mangas.
1998 :
la chaîne (satellite) de télé AB Cartoons est renommée Mangas.
À la télévision, les Pokémons arrivent et font craindre des crises
d’épilepsie33. Entre fans, une
guerre se déclare entre ceux qui aiment les pokémon (pocket
monsters) ou ceux qui préfèrent les digimon (digital monsters).
Les animés qui restent
diffusés sur le petit écran sont pour un jeune public, mais on s’en
fout : on regarde quand même.
Clothide Sabre synthétise les informations de l’ACBD34 (bilan 2007) : « Les tirages sont passés de six séries traduites en 1991 à plus de mille depuis 2005, avec une part de marché de plus de 40 % dans le domaine de la bande dessinée.
À partir de 2000, les chiffres de ventes des
mangas explosent. Cela continue de monter jusqu’en 2008, année
qui a marqué son apogée en France : on a publié 1 288 nouveaux
volumes de mangas, presque tous dans leur format d’origine (ce qui
n’était pas le cas des premières publications), et il s’en est vendu
12,4 millions, soit 37 % des ventes totales de bande dessinée. En
dépit d’un certain tassement on recensait en 2011 dans les catalogues
des éditeurs français plus de 750 séries japonaises et quelques 500
auteurs35».
 En
2003, les éditions Ki-oon se lance dans l’aventure. Contrairement
à d’autres éditeurs, Ki-oon ne s’appuie ni sur un gros groupe ni sur une
librairie. Il marque les esprits en publiant des séries adultes et
sombres comme Doubt (manga JP 2007 / FR Ki-oon 2009) et Judge
(manga JP 2010 / FR Ki-oon 2011).
En
2003, les éditions Ki-oon se lance dans l’aventure. Contrairement
à d’autres éditeurs, Ki-oon ne s’appuie ni sur un gros groupe ni sur une
librairie. Il marque les esprits en publiant des séries adultes et
sombres comme Doubt (manga JP 2007 / FR Ki-oon 2009) et Judge
(manga JP 2010 / FR Ki-oon 2011).
Des éditeurs indépendants, voire élitistes commencent à se mêler de
mangas : Vertige Graphic republie Gen d’Hiroshima36 (à partir de 2003), Ego comme X
publie l’Homme sans talent de Yoshiharu Tsuge (2003) et
Cornélius37, NonNonBâ
de Shigeru Mizuki (qui obtient le prix du meilleur album à Angoulême en
2007). Les Humanoïdes Associés font le pari que le manga
français peut marcher et sort un magazine de prépublication (Shogun
Magazine), ainsi qu’une collection consacrée à ce type de BD. 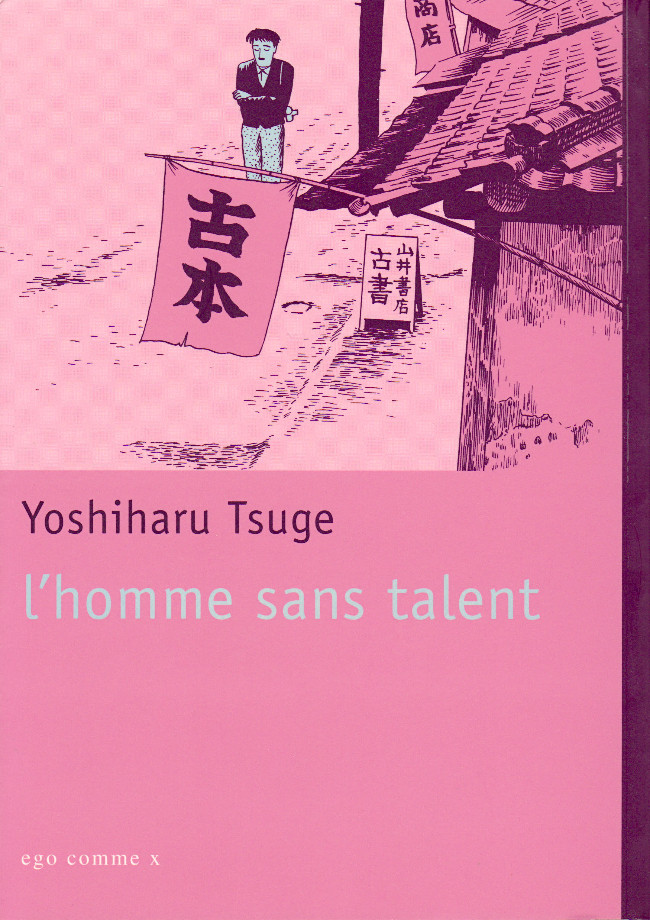
 Question
vidéo : en 2006, apparaît Crunchyroll qui offre une
alternaive payante et légale au streaming et aux téléchargements
illégaux (parfois fansubbés).
L’accès aux dessins animés n’est plus un soucis depuis déjà quelques
années.
Question
vidéo : en 2006, apparaît Crunchyroll qui offre une
alternaive payante et légale au streaming et aux téléchargements
illégaux (parfois fansubbés).
L’accès aux dessins animés n’est plus un soucis depuis déjà quelques
années.
De 2008 à 2015, c’est la crise : le marché du
manga se retrouve en difficulté. Après une période de faste où l’on
voyait des chiffres extraordinaires et une croissante quasi-surnaturelle
(notamment entre 2001 et 2008), les ventes de mangas
baissent. Les problèmes viennent du fait que le manga est porté par des
titres-phares. Les éditeurs pouvaient les sortir rapidement et fidéliser
un lectorat de plus en plus nombreux… ou presque. Le « taux de
conversion » au manga a fini par être moins élevé et les parutions
s’espacent car les éditeurs français ont rattrapé le rythme japonais.
Les chiffres baissent, le marché repose sur les séries à succès.
Les éditeurs craignent la fin de ces séries, car contrairement à ce qui
s’est passé aux débuts des années 2000, on ne voit pas de
successeurs à Naruto, One Piece… Alors les auteurs prolongent ces
séries et les éditeurs ressortent des vieilleries qui font toujours des
ventes.
Depuis 2015, le marché se porte mieux. Avec le Grand Prix du
festival internationale de BD d’Angoulême remis à Rumiko Takahashi en 2019,
on ne peut qu’être optimiste. Elle est la troisième mangaka récompensée
à ce festival après Akira Toriyama en 2013 (Prix du 40e
anniversaire) et Katsuhiro Otomo, grand prix en 201538 depuis la création de ce prix et de
l’événement en 1974.
La France est le deuxième pays consommateur de manga derrière le
Japon...